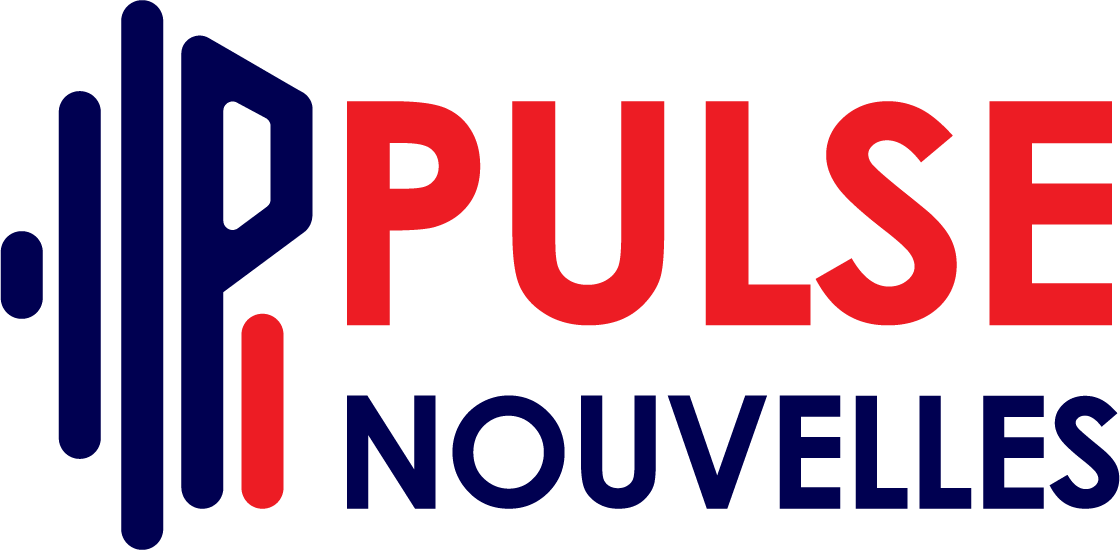Port-au-Prince, 18 septembre 2025 — Dans une déclaration officielle relayée récemment par l’ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, le directeur du FBI, Kash Patel, a affirmé que Haïti constitue désormais un point de passage stratégique dans le transit de la cocaïne en provenance d’Amérique du Sud vers les États-Unis. Selon lui, une grande partie de cette drogue, dont l’origine est principalement localisée au Venezuela, transite par les Caraïbes via Haïti, avant d’atteindre le marché nord-américain.
« Une grande partie de la cocaïne en provenance d’Amérique du Sud, son point d’origine est au Venezuela, et les trafiquants utilisent des points de transbordement à travers Haïti… dans les Caraïbes jusqu’à l’État final de livraison qui est les États-Unis d’Amérique. Et nous traquerons chacun de ces narco-trafiquants », a-t-il déclaré lors d’une audition au Congrès américain.
Cette affirmation ne surprend guère les spécialistes de la sécurité régionale. Depuis plusieurs années déjà, les rapports du Département d’État américain et de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) pointent Haïti comme un maillon vulnérable du vaste réseau de narcotrafic opérant entre l’Amérique du Sud et les États-Unis. Les routes maritimes qui longent les côtes haïtiennes sont devenues des couloirs logistiques pour les cartels, profitant du manque de contrôle, de la faiblesse des institutions, et de l’instabilité chronique qui frappe le pays.
Les trafiquants utilisent principalement de petites embarcations rapides, des avions légers ou des conteneurs maritimes pour acheminer la drogue depuis le Venezuela ou la Colombie jusqu’aux côtes haïtiennes. Une fois sur place, les cargaisons sont entreposées ou directement redistribuées vers d’autres points dans la région — République dominicaine, Porto Rico, Bahamas — voire expédiées clandestinement vers la Floride. Ce transit s’effectue souvent avec la complicité de réseaux locaux, parfois liés à des groupes armés qui contrôlent des portions entières du territoire.
Les conséquences pour Haïti sont considérables. Ce flux de stupéfiants contribue directement au financement des gangs armés, qui alimentent la violence endémique dans la capitale et dans plusieurs régions du pays. Il affaiblit encore davantage un État déjà fragilisé par une crise multidimensionnelle — politique, économique, sociale et sécuritaire. La population civile, quant à elle, subit les effets d’un climat d’insécurité permanent, particulièrement dans les zones côtières devenues stratégiques pour les narcotrafiquants.
Sur le plan diplomatique, les propos du FBI marquent également un tournant. Ils annoncent une intensification probable de la pression américaine pour un renforcement de la coopération sécuritaire. Des opérations conjointes entre la DEA, la police haïtienne, la Garde côtière américaine et d’autres partenaires régionaux pourraient se multiplier dans les mois à venir. En parallèle, Washington pourrait conditionner une partie de son aide à une reprise effective du contrôle territorial par les autorités haïtiennes.
Face à cette réalité, plusieurs questions demeurent. Haïti dispose-t-elle encore des moyens nécessaires pour sécuriser ses frontières maritimes et aériennes ? Les institutions judiciaires et policières sont-elles en mesure de résister à l’influence des groupes criminels organisés ? Et surtout, quelles garanties de souveraineté peuvent être préservées dans un contexte de coopération sécuritaire croissante avec des puissances étrangères ?
Il est clair que la lutte contre le narcotrafic ne pourra pas être menée efficacement sans une réforme structurelle des institutions haïtiennes. Cela passe par le renforcement des capacités opérationnelles de la police, la relance du système judiciaire, la modernisation des douanes et le contrôle strict des ports et aéroports. Mais cela exige aussi une volonté politique forte, un appui cohérent et non intrusif de la communauté internationale, ainsi qu’un engagement réel de la société civile haïtienne.
Dans un contexte déjà tendu, le rôle de plus en plus central qu’occupe Haïti dans les routes du trafic de cocaïne illustre l’urgence d’un sursaut collectif. Car au-delà des enjeux géopolitiques, c’est l’avenir même du pays, sa stabilité et sa souveraineté, qui sont en jeu.