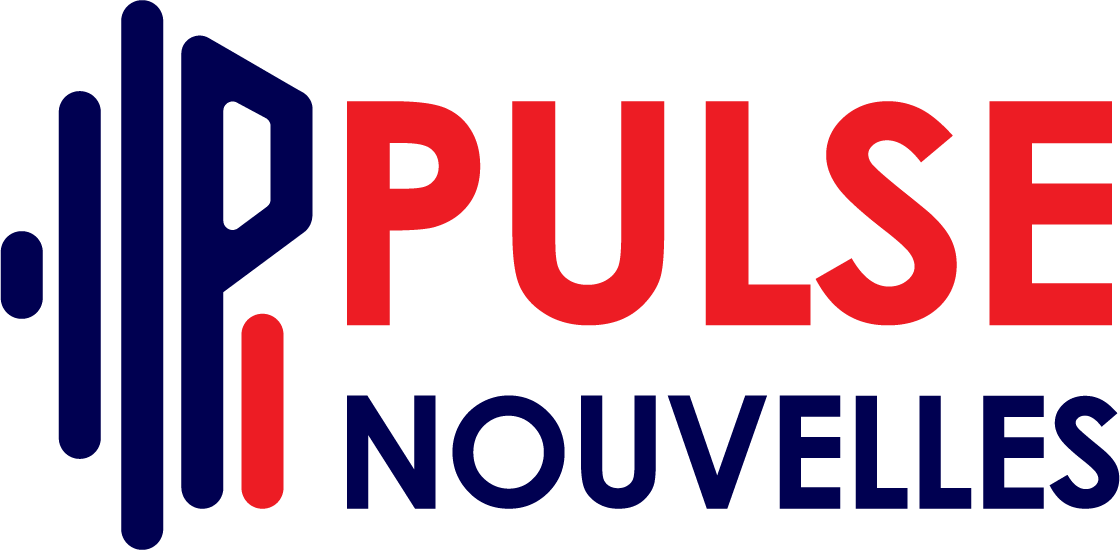Les autorités américaines ont intercepté, depuis le début de l’année 2025, plus de 23 000 armes à feu et une quantité importante de drogues en route vers Haïti. Montant estimé de la saisie : un million de dollars. Derrière ce chiffre, c’est l’ampleur d’un système criminel international qui se confirme, alimentant la spirale de violence qui ravage le pays.
Une cargaison de guerre stoppée net
C’est une saisie d’une ampleur exceptionnelle : 23 000 armes à feu, accompagnées de produits stupéfiants, ont été interceptées aux États-Unis alors qu’elles étaient destinées à être acheminées vers Haïti. Les services de sécurité américains, en collaboration avec d’autres agences fédérales, ont empêché qu’un arsenal estimé à plus d’un million de dollars ne tombe entre les mains des groupes armés qui contrôlent une large partie du territoire haïtien.
Selon l’ambassade américaine à Port-au-Prince, ces armes étaient destinées à alimenter directement les gangs haïtiens. Ces derniers, devenus les véritables maîtres de plusieurs régions du pays, mènent une guerre quotidienne contre la population, les forces de l’ordre, et toute tentative de retour à la stabilité.
Un trafic bien rodé
Ces armes, souvent dissimulées dans des conteneurs de marchandises légales, proviennent en grande partie des États du sud des États-Unis, là où les lois sur le port d’armes sont les plus permissives. Une fois sur le sol haïtien, elles sont revendues à prix fort aux bandes criminelles telles que Gran Grif, Viv Ansanm, ou encore 5 Segond, qui n’ont aucun mal à s’en procurer grâce à un réseau bien structuré.
« Chaque arme interceptée est une vie potentiellement sauvée », a déclaré un responsable américain sous couvert d’anonymat. Mais la réalité reste préoccupante : beaucoup d’autres cargaisons échappent à tout contrôle et traversent les frontières maritimes sans rencontrer de résistance.
Haïti, plaque tournante géographique
La situation géographique d’Haïti, entre les principaux producteurs de drogues sud-américains et le marché américain, en fait une zone de transit idéale. Ses côtes étendues, ses ports faiblement surveillés, et la porosité de sa frontière avec la République dominicaine facilitent l’acheminement de cargaisons illégales.
L’ancienne administration Trump a récemment inclus Haïti sur la liste noire des 23 pays considérés comme des plateformes d’exportation ou de transit de drogues vers les États-Unis. Une classification qui suscite la colère, mais aussi l’inquiétude, tant elle illustre l’effondrement des capacités de contrôle de l’État haïtien.
Les avertissements de Washington
En réaction, les États-Unis adoptent un ton plus ferme. Henry Wooster, chargé d’affaires américain en Haïti, a lancé une mise en garde directe contre les complicités entre acteurs politiques et groupes armés. Il a évoqué une tolérance zéro envers ceux qui entravent la transition politique ou utilisent les gangs comme levier d’influence.
Une déclaration perçue comme un message clair à l’élite haïtienne. Car, dans ce système, les armes n’arrivent pas seules : elles sont souvent accompagnées de complicités locales, dans les douanes, au sein des institutions, ou encore dans la sphère politique.
Conséquences humaines et économiques
Les conséquences sur le terrain sont dramatiques. À ce jour, plus de 1,3 million de personnes sont déplacées à l’intérieur du pays, fuyant les violences des gangs. Des centaines d’écoles sont fermées, les hôpitaux sont à l’arrêt, et la vie économique est paralysée dans de nombreuses zones.
Dans la diaspora, ces révélations confirment les craintes. Plusieurs Haïtiens vivant à l’étranger ont annulé leurs projets de retour ou d’investissement. « Comment envisager de construire quand la destruction arrive par conteneurs ? », se demande un entrepreneur haïtien basé à Montréal.
Une coopération à renforcer
L’ambassade américaine a réitéré sa volonté de travailler avec les autorités haïtiennes pour lutter contre ce trafic. Mais dans un pays où l’État ne contrôle plus que quelques institutions fragiles, cette collaboration apparaît à la fois indispensable et insuffisante.
Le projet américain de soutien à une force internationale spécialisée dans la lutte contre les gangs revient sur la table. Sur le terrain, les gangs disposent non seulement d’armes lourdes, mais aussi d’un sentiment d’impunité renforcé par la faiblesse des institutions judiciaires et policières.
Une victoire partielle, une guerre loin d’être finie
L’interception de cette cargaison est une victoire. Mais elle ne doit pas masquer l’essentiel : d’autres cargaisons arriveront tant que les racines du problème — corruption, impunité, défaillance de l’État — ne seront pas arrachées.
La guerre contre les armes illégales ne se gagnera pas uniquement aux postes-frontières américains. Elle se gagnera, ou se perdra, en Haïti, dans notre capacité collective à rebâtir un État digne de ce nom.