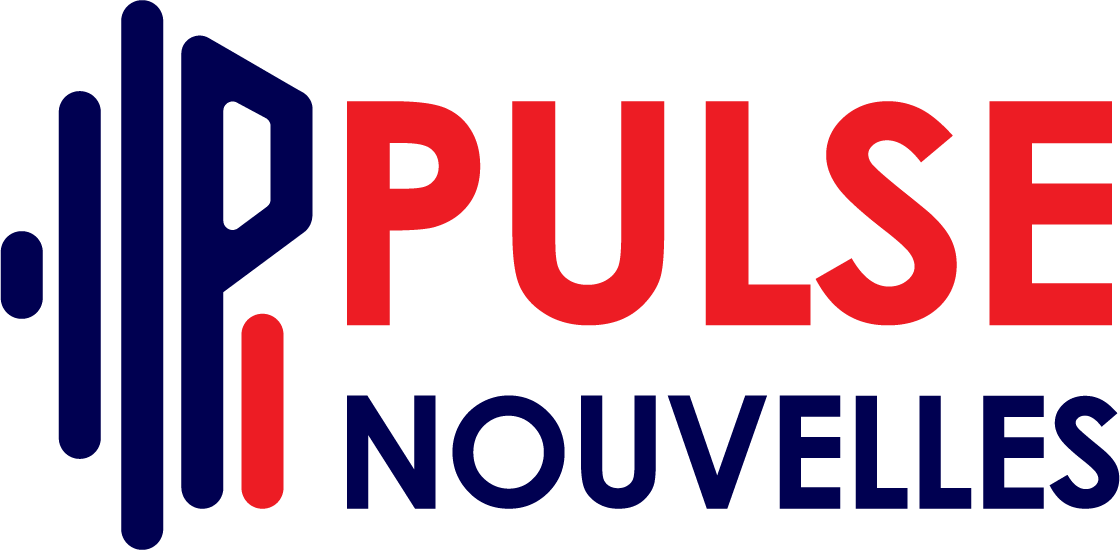Adoptée récemment à l’Assemblée nationale française, une résolution non contraignante a suscité un regain d’attention autour d’un dossier historique explosif : la dette imposée à Haïti en 1825 par la France. Bien qu’elle n’ait pas de valeur juridique, cette prise de position représente une avancée politique et symbolique majeure, ouvrant la voie à des discussions sur la justice mémorielle et les réparations post-coloniales.
Le texte invite la République française à reconnaître publiquement l’injustice coloniale faite à Haïti, à en mesurer les impacts sur le développement du pays, et à envisager des mesures de réparation. Il recommande également la création d’une commission indépendante chargée d’accompagner les initiatives mémorielles et de justice réparatrice entre les deux nations.
Cette résolution fait directement écho à l’indemnité de 150 millions de francs-or imposée par le roi Charles X en 1825 — plus tard réduite à 90 millions. Ce montant visait à indemniser les anciens colons français pour la perte de leurs « biens », incluant les personnes réduites en esclavage. Contraint sous la menace d’une intervention militaire, Haïti a été forcée de contracter de lourds emprunts à des taux usuraires auprès de banques françaises, s’enfonçant dans une spirale d’endettement qui ne s’est achevée qu’en 1952.
Pour la Fondation pour la mémoire de l’esclavage (FME), cette injustice historique constitue une « double dette » : celle de l’indemnité elle-même, et celle des emprunts contractés pour la rembourser. Une charge financière qui aurait durablement freiné le développement d’Haïti et contribué à sa vulnérabilité économique actuelle.
En avril 2025, le président Emmanuel Macron a annoncé la création d’une mission de mémoire conjointe France-Haïti, mais sans évoquer d’éventuelle compensation financière. Une demi-mesure selon de nombreux responsables haïtiens et militants, qui estiment que la reconnaissance n’est complète qu’avec une réparation concrète.
Ce débat remonte notamment à 2003, lorsque l’ancien président haïtien Jean-Bertrand Aristide avait réclamé 21,7 milliards de dollars à la France, relançant à l’époque les discussions internationales sur les réparations coloniales.
Lors des débats au Palais Bourbon, le ministre délégué à la Francophonie, Thani Mohamed Soilihi, a émis un « avis de sagesse », suggérant une forme d’ouverture du gouvernement. À l’opposé, le député d’extrême droite Emeric Salmon a exprimé son inquiétude face au « précédent dangereux » que constituerait un remboursement officiel.
Même sans portée légale, cette résolution marque une rupture : la France admet pour la première fois, sur le plan institutionnel, l’existence d’une dette morale envers Haïti. Une avancée symbolique forte, qui pourrait faire pression pour que l’histoire cesse d’être une cicatrice ouverte, et devienne enfin un levier de réparation.