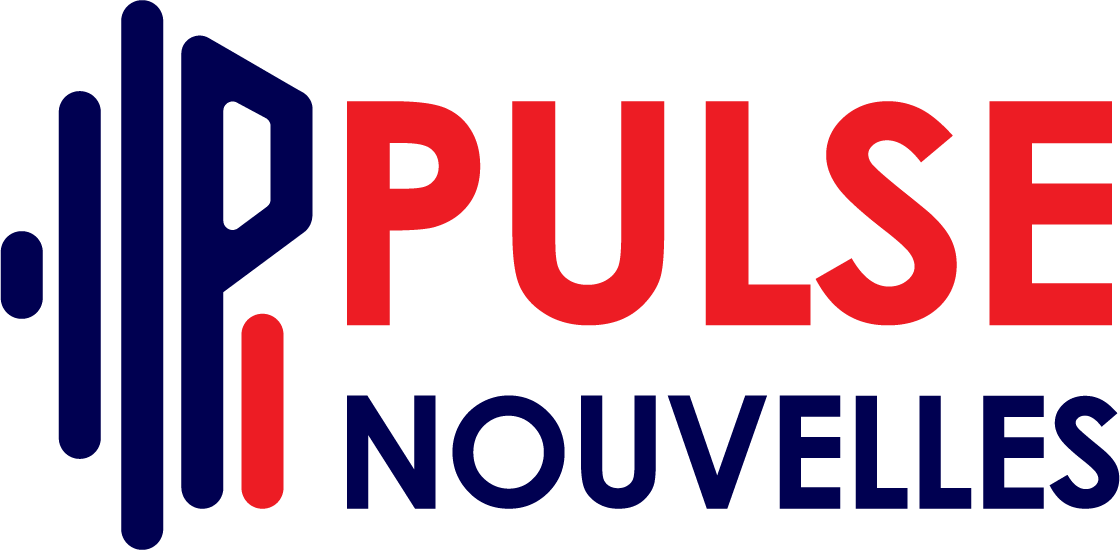L’Hôpital de l’Université d’État d’Haïti (HUEH), communément appelé Hôpital Général, est aujourd’hui à l’arrêt, victime collatérale d’un climat d’insécurité généralisée. Ce géant du système de santé haïtien, situé au cœur de Port-au-Prince, n’est pas qu’un simple hôpital : c’est un pilier, une référence, un centre de formation, un lieu de recherche. Sa fermeture brutale ne marque pas uniquement l’arrêt d’un service de santé, mais annonce une hémorragie dans tout le réseau sanitaire du pays.

Un pilier du système de santé haïtien
Créé en 1916 et officiellement érigé en Hôpital universitaire en 1968, l’HUEH est au sommet de la pyramide sanitaire haïtienne. Il fait partie du troisième niveau du système de santé, là où se concentrent les soins tertiaires les plus spécialisés. L’HUEH regroupe des services de référence nationale : grands brûlés, dialyse, ORL, urologie, néonatologie… Il est également le plus grand hôpital public du pays, accessible à une population pour qui l’accès aux soins est déjà extrêmement restreint.
Mais l’HUEH n’est pas seulement un centre de soins. C’est aussi le cœur de la formation des professionnels de santé en Haïti. Chaque année, plus de 500 étudiants en médecine, en soins infirmiers ou en maïeutique y font leur formation pratique. Il est le principal terrain d’apprentissage pour la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l’UEH, ainsi que pour d’autres institutions en santé.
Un système déjà à genoux
Avant même la fermeture de l’HUEH, le système de santé haïtien était en crise. À peine 10 % de la population vit à moins d’un kilomètre d’un centre de santé. Environ 22 % du territoire n’a aucune infrastructure sanitaire. Les dépenses publiques de santé ne dépassent pas 7 dollars par habitant, contre 270 dollars chez le voisin dominicain. Moins de 10 % des Haïtiens bénéficient d’une assurance santé, et l’espérance de vie peine à atteindre 64 ans.
La perte du plus grand hôpital du pays dans ce contexte revient à couper le dernier fil d’un filet déjà troué.
Cible de l’insécurité généralisée
Le 29 février 2024, des groupes armés ont lancé une offensive à grande échelle à Port-au-Prince. L’HUEH, pourtant symbole de secours et de soins, n’a pas été épargné. Attaques armées, pillages, incendies… le chaos a forcé l’évacuation du personnel et la fermeture des portes de l’établissement.
Les conséquences sont tragiques : des milliers de patients abandonnés, des urgences non traitées, une hausse du taux de mortalité, mais aussi une interruption brutale des parcours de formation de centaines de futurs médecins et soignants. En parallèle, le personnel de santé – déjà insuffisant – est poussé à l’exil ou au silence, épuisé et menacé.
Quelles solutions face à cette urgence nationale ?
Face à cette catastrophe, les étudiants en sciences de la santé, les médecins et les professionnels du secteur s’organisent pour alerter, proposer et exiger :
- Une sécurisation immédiate de l’HUEH et de ses alentours, pour permettre une reprise progressive des activités.
- Un plan de relocalisation temporaire des services critiques afin de garantir la continuité des soins urgents.
- Le renforcement de la protection du personnel de santé, devenu cible au lieu d’être ressource.
- Une réforme structurelle du système de santé, intégrant des investissements conséquents dans les infrastructures, la formation, et l’accès universel aux soins.
L’insécurité : obstacle majeur au droit à la santé
L’exemple de l’HUEH illustre avec violence comment l’insécurité affecte directement le droit fondamental à la vie et à la santé. Dans un pays où se faire soigner devient un parcours de survie, où les hôpitaux sont pris pour cible et où les médecins doivent fuir pour vivre, il devient urgent d’agir. L’effondrement de l’HUEH n’est pas un fait divers : c’est le symptôme d’un système malade que l’on ne peut plus ignorer.