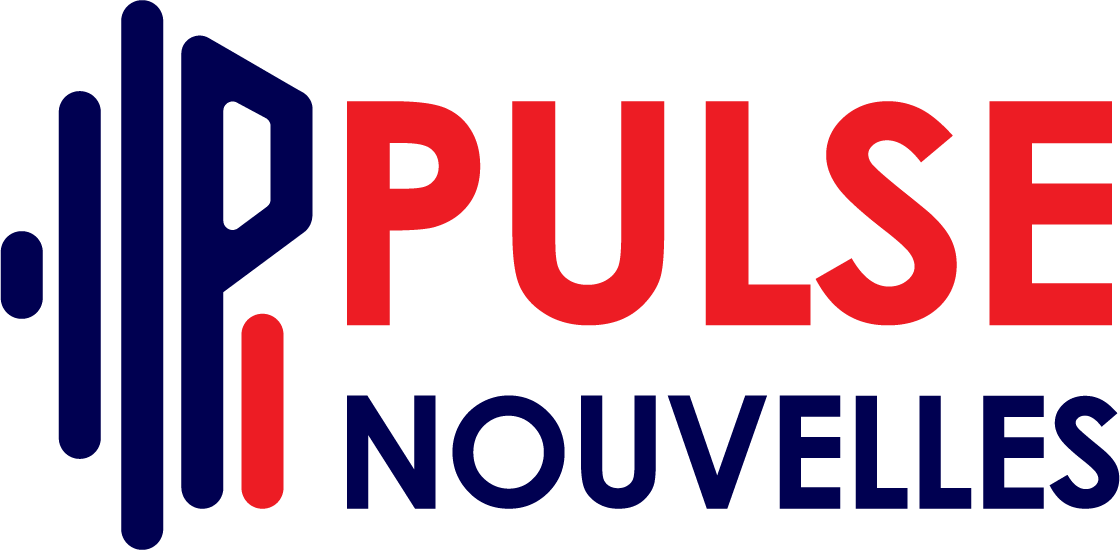Sanction migratoire américaine : EDE dénonce une punition collective injuste
Dans une lettre officielle datée du 5 juin 2025, le parti Les Engagés pour le Développement (EDE), mené par l’ancien Premier ministre Claude Joseph, a interpellé le secrétaire d’État américain Marco Rubio. Objectif : dénoncer les effets disproportionnés de la récente interdiction d’entrée sur le territoire américain visant les ressortissants de douze pays, dont Haïti.
Dans une démarche à la fois critique et diplomatique, EDE dit prendre acte de cette décision « aux effets dévastateurs » et en appelle à une révision ou à un assouplissement de la mesure, « tenant compte de la réalité dramatique du peuple haïtien ».
Une décision-choc, des conséquences lourdes
Cette mesure, prise par l’administration Trump sous prétexte de « préserver la sécurité intérieure » face au dépassement de visa, prive d’entrée aux États-Unis les citoyens haïtiens, même ceux en quête de soins médicaux, d’opportunités éducatives ou de simples retrouvailles familiales.
Pour EDE, cette politique migratoire ne distingue pas les profils, et agit comme une punition collective. Dans la lettre signée par Claude Édouard (secrétaire général) et Claude Joseph (président du Conseil stratégique), le parti exprime son inquiétude face à « une mesure qui ignore les efforts des citoyens haïtiens respectueux des lois et le contexte d’extrême précarité sociale ».
Une crise migratoire nourrie par une histoire oubliée
EDE ne se contente pas de dénoncer : le parti remonte aux racines de la crise migratoire haïtienne. Il évoque la dette d’indépendance imposée par la France en 1825, avec l’appui tacite des puissances occidentales. Cette dette, souligne la lettre, a littéralement saigné l’économie haïtienne, empêchant toute construction durable d’infrastructures, d’institutions éducatives ou de stabilité économique.
Ce traumatisme historique expliquerait, selon EDE, les flux migratoires actuels et le taux élevé de dépassement de visas, non pas comme une fraude volontaire, mais comme un cri de détresse.
Entre reconnaissance et dénonciation
EDE reconnaît néanmoins les efforts de l’administration américaine dans la lutte contre l’insécurité en Haïti, notamment la réponse positive de Washington à la demande de désignation de certains gangs haïtiens comme organisations terroristes.
Mais pour le parti, la satisfaction face à cette coopération sécuritaire ne peut occulter les injustices d’une décision migratoire « aveugle ». En rappelant que la diaspora haïtienne joue un rôle économique vital pour son pays – représentant plus de 20 % du PIB via les transferts – EDE appelle à une vision plus humaine et équilibrée des relations bilatérales.
Un appel à bâtir des ponts, pas des murs
Dans un ton empreint d’histoire et de diplomatie, le parti rappelle aussi le rôle indirect mais décisif de la Révolution haïtienne dans la vente de la Louisiane en 1803 – un épisode fondateur dans l’expansion des États-Unis. Ce rappel historique vise à souligner les liens profonds, souvent oubliés, entre les deux nations.
EDE conclut sa lettre en plaidant pour « la construction de ponts plutôt que l’érection de murs », demandant une révision urgente de la mesure ou, à défaut, un mécanisme d’exception humanitaire pour les cas les plus vulnérables : étudiants, familles séparées, malades, professionnels respectueux des lois.
Alors que le ministère haïtien des Affaires étrangères appelle au dialogue, EDE s’impose comme la première voix politique locale à dénoncer publiquement une mesure qualifiée de « discriminatoire » par Amnesty International.